« Je trouve très raisonnable la croyance celtique que les âmes de ceux que nous avons perdus sont captives dans quelque être inférieur, dans une bête, un végétal, une chose inanimée, perdues en effet pour nous jusqu’au jour, qui pour beaucoup ne vient jamais, où nous nous trouvons passer près de l’arbre, entrer en possession de l’objet qui est leur prison. Alors elles tressaillent, nous appellent, et sitôt que nous les avons reconnues, l’enchantement est brisé. Délivrées par nous, elles ont vaincu la mort et reviennent vivre avec nous.
Il en est ainsi de notre passé. C’est peine perdue que nous cherchions à l’évoquer, tous les efforts de notre intelligence sont inutiles.
[…] un jour d’hiver, comme je rentrais à la maison, ma mère, voyant que j’avais froid, me proposa de me faire prendre, contre mon habitude, un peu de thé. Je refusai d’abord et, je ne sais pourquoi, me ravisai. Elle envoya chercher un de ces gâteaux courts et dodus appelés Petites Madeleines qui semblent avoir été moulés dans la valve rainurée d’une coquille de Saint-Jacques. Et bientôt, machinalement, accablé par la morne journée et la perspective d’un triste lendemain, je portai à mes lèvres une cuillerée de thé où j’avais laissé s’amollir un morceau de madeleine […]. »
Du Côté de chez Swann.
Un peu avant Einstein et à sa manière, Proust invente la théorie de la relativité [1].
On peut selon lui faire revivre le passé et retrouver le temps perdu, ou plutôt recréer un temps plus réel que ce que les lieux, les personnes et les événements ont pu être. Pour Proust, « le passé se [retrouve] au bout du temps dans un présent impérissable, plus vrai et plus riche encore qu’à l’origine » (Camus, L’Homme révolté).
Seulement, cette faculté de ressusciter les êtres et les choses n’est pas toute-puissante. Elle dépend de la réminiscence, de la mémoire involontaire, que À la Recherche du temps perdu incarne par exemple dans la fameuse madeleine qui rappelle son enfance au narrateur, ou dans la sonate de Vinteuil qui rappelle à Swann son amour pour Odette. Ces instants très courts ressuscitent des morceaux du passé. Ils sont le signe qu’à l’intérieur de chaque être reposent des moments privilégiés qui résistent à la destruction du temps. Ils affleurent dans les rêves ou lorsqu’un sens réactive la mémoire involontaire [2].
Le personnage principal de la Recherche est ainsi le temps destructeur, qui fait mourir des personnages (Vinteuil, Swann, la grand-mère du narrateur, Albertine, Bergotte, Saint-Loup) ou mal vieillir d’autres, tels Odette ou la duchesse et le duc de Guermantes, flamboyants quelques années plus tôt ; qui révèle l’homosexualité d’un certain nombre (Charlus, Albertine…) ; qui fait se transformer l’aristocratie par l’arrivée de « transferts » de la bourgeoisie (Madame Verdurin devient princesse de Guermantes et Odette Swann, de demi-mondaine, devient comtesse de Forcheville) ; qui bouleverse la société livrée entière à des passions comme l’affaire Dreyfus et la guerre. « Chacun croit ses passions absolues, éternelles, mais le courant implacable emporte vainqueurs et vaincus, et tous se retrouvent vieillis, proches de la mort, apaisés par la faiblesse, autour de leur passions refroidies et d’une lave durcie, inoffensive. […] [La Recherche est] l’histoire de la découverte par Marcel de tout ce qui était caché derrière les noms, de son effort pour conquérir ce qu’il a tant désiré, de ses inévitables et totales déceptions » (André Maurois, À La Recherche de Marcel Proust).

- Le Pré Catelan
Le narrateur désire l’amour de Gilberte Swann mais finit par l’oublier à tel point qu’il ne la reconnaîtra pas. Il part aussi en quête de l’amour des jeunes filles de Balbec et d’Albertine Simonet, qu’il n’aimera que plus tard, après l’avoir connue. Même expérience, enfin, avec la duchesse de Guermantes, dont il parvient à se rapprocher, mais pour découvrir la cruauté du monde dans lequel elle vit. Même sa mère et sa grand-mère, dont il croyait qu’elles pouvaient remplir son monde, n’y ont pas suffit.
La raison qui pousse Proust à écrire est celle qu’explique le narrateur dans la dernière partie de la Recherche, Le Temps retrouvé : « Il faut faire œuvre d’art » pour que revive ce qui a disparu. L’art seul permet d’atteindre l’essence des choses en avançant sur les chemins ouverts par la réminiscence.
[…] je ne leur demanderai pas [aux lecteurs] de me louer ou de me dénigrer, mais seulement de me dire si c’est bien cela, si les mots qu’ils lisent en eux-mêmes sont bien ceux que j’ai écrits (les divergences possibles à cet égard ne devant pas, du reste, provenir toujours de ce que je me serais trompé, mais quelquefois de ce que les yeux du lecteur ne seraient pas de ceux à qui mon livre conviendrait pour bien lire en soi-même).
Si Proust compose sa fresque entre 1909 et 1922, alors que la fin de l’affaire Dreyfus et la Première guerre mondiale précipitent la disparition de l’aristocratie d’avant-guerre, la Recherche n’est ni un hymne à la gloire du faubourg Saint-Germain, ni un hymne au passé, ni à l’enfance : c’est bien un hymne à l’art.
Il n’est pas de ces écrivains fascinés par le clinquant d’une classe qui, s’en approchant le plus près possible, l’observent, prennent note et s’en retirent pour la décrire à l’écart. Certes, il a bien été attiré par cette société qui vit dans le faubourg Saint-Germain et « du côté de Guermantes », près du Combray de la Recherche. Il s’est éreinté à y pénétrer grâce à Robert de Montesquiou et à d’autres [3]. Mais son intelligence autant que son asthme qui le cloue au lit l’en ont peu à peu éloigné.
Parmi les différents personnages du roman, un seul atteint son but, tel que l’explique Le Temps retrouvé. Ce ne sont pas les comtes et les duchesses, c’est bien le narrateur, lorsqu’il abandonne l’idée de trouver la meilleure place possible « du côté de Guermantes » et se fixe comme objectif de transformer, par l’écriture, la vie vécue en beauté, à l’image du travail de Bergotte l’écrivain, de Vinteuil le compositeur ou d’Elstir le peintre.
*
Le temps destructeur de la Recherche fait aussi changer les lieux. Paris est ainsi un décor évoluant avec le temps : ville des amours premiers puis mûrs, ville de l’aristocratie et de ses salons, de Sodome et Gomorrhe et de la guerre, et enfin ville du temps retrouvé.
Les lieux parisiens de La Recherche (il y a aussi, bien sûr, Illiers) se déploient dans un périmètre restreint : à part une ou deux incursions dans la partie est (vers les buttes-Chaumont-La Villette), le roman se déroule dans deux quartiers : d’une part le faubourg Saint-Germain (aristocratique) et l’île Saint-Louis (grand-bourgeois), d’autre part le quart Nord-Ouest de la ville (bourgeois).
Proust y promène ses personnages depuis son lit du 2e étage du 102 boulevard Haussmann. Il se contente de situer ou citer les lieux (attribuant rarement à un hôtel un numéro dans une rue), sans les décrire. Les lieux ne sont pas à ses yeux inscrits dans l’espace, mais dans le temps et les sentiments. L’important pour lui n’est pas de peindre fidèlement un décor, mais de dire les sentiments éprouvés par les personnages qui s’y trouvent. L’exemple extrême en est l’hôtel de Guermantes, dont, on le verra, on peine à situer l’endroit tant il est immatériel et intemporel. Le travail de Proust, isolé dans son « arche de Noé », est de retrouver par la mémoire, par une sortie « dans le monde » ou par l’intermédiaire de l’un de ses visiteurs-enquêteurs, des émotions qu’il approfondit ensuite et décrit de manière à les faire ressentir par le lecteur.
Voici cinq balades parisiennes dans les pas de Proust, de ses parents et amis et de ses personnages. Si la mémoire involontaire n’opère pas… parcourez ces lieux la Recherche à la main !
BALADE DE LA RUE D’AUTEUIL AU PRÉ CATELAN
Départ : métro Michel-Ange Auteuil.
Arrivée : métro Avenue Henri-Martin.
Durée de la balade : 1h30.
1) Le 73 rue d’Auteuil est le domicile de Ludovic Halévy, père de Daniel, ami de lycée de Marcel.
2) Marcel naît en juillet 1871 au 96 rue La Fontaine (plaque). C’est depuis 1857 la maison de Louis Weil, où les Proust passent l’été jusqu’à la mort de Louis en 1896. Louis est l’oncle de Jeanne Proust, mère de Marcel. Il s’est enrichi grâce à son entreprise de boutons, la plus importante de Paris. Il est aussi propriétaire du 102 boulevard Haussmann, où Marcel habite entre 1906 et 1919. Voici la description de la maison que donne Evelyne Bloch-Dano dans Madame Proust : « La demeure est vaste, avec ses vingt-neuf fenêtres, ses deux étages, auxquels s’ajoute un troisième mansardé. Elle est bâtie au milieu d’un terrain tout en longueur de 1 500 m2 qui relie la rue La Fontaine à la rue de la Source. Une écurie pour deux chevaux et une remise pour deux voitures ont été ajoutées près de l’entrée. En 1876, l’oncle Louis a fait construire une aile supplémentaire destinée à la famille Proust : deux chambres au premier étage et deux au deuxième. » Une petite porte rue de la Source s’ouvre sur le jardin.
Le lieu de naissance de Marcel est symbolique. C’est bien la famille maternelle, les Weil, juifs intégrés [4], qui absorbe les Proust, appartenant à la petite bourgeoisie de province.
La rue La Fontaine, c’est aussi la campagne, même si c’est la campagne à Paris. Auteuil est ainsi avec Illiers le berceau de l’enfance rêvée de Marcel [5].
Jeanne a eu peur de perdre son premier fils Marcel à la naissance, et peut-être dès sa grossesse. Cette angoisse maternelle accompagne le jeune garçon dans ses premières années. Celui-ci la fait rapidement sienne, supportant difficilement l’éloignement même temporaire de sa mère. Du supplice de la séparation et de cette angoisse qui se cristallise au moment du coucher, il fera le centre de la Recherche.
Adrien, le père, est exclu de cette relation mère-fils. Jeanne compense la présence réduite au domicile familial de son mari, pris par ses occupations professionnelles.
La nouvelle avenue Mozart – dont le creusement entre Passy et Auteuil s’étend sur une trentaine d’années ! – éventre le jardin en 1881. La maison natale est détruite en 1897.
Dans Jean Santeuil et La Recherche, les descriptions des soirs d’été passés dans le jardin s’inspirent autant des soirées passées rue La Fontaine que de celles d’Illiers.
3) C’est dans le bois de Boulogne qu’en avril ou mai 1881 Marcel subit une première et terrible crise d’asthme. Son père médecin et un ami chirurgien assistent impuissants à la scène, de même que Mme Proust. Quelques années plus tard, Adrien Proust préfacera un livre d’un confrère sur L’hygiène des asthmatiques, y laissant poindre la vision très pessimiste qu’il a de cette maladie.

- Le Pré catelan, intérieur
4) Dans le roman, les Verdurin organisent des soirées au bois de Boulogne, dans le restaurant le Châlet des Iles, sur l’île du Bois au milieu du grand lac, aussi appelée « île des Cygnes ». C’est ici que Swann entend à nouveau la sonate de Vinteuil, qui lui remémore le temps où il était aimé d’Odette.

- Le Chalet des Iles
5) Le restaurant du Pré Catelan, route de Suresnes dans le bois de Boulogne, ouvre ses portes à la bonne société dans les premières années du XXe siècle. Il voit passer Proust et ses personnages.
Une image offerte par la vie, nous apporte en réalité à ce moment-là des sensations multiples et différentes. La vue par exemple de la couverture d’un livre déjà lu a tissé dans les caractères de son titre les rayons de lune d’une lointaine nuit d’été. Le goût du café au lait matinal nous apporte cette vague espérance d’un beau temps qui jadis si souvent pendant que nous le buvions dans un bol de porcelaine blanche, crémeuse et plissée qui semblait du lait durci, se mit à nous sourire dans la claire incertitude du petit jour. Une heure n’est pas qu’une heure, c’est un vase rempli de parfums, de sons, de projets et de climats. Ce que nous appelons la réalité est un certain rapport entre ces sensations et ces souvenirs qui nous entourent simultanément – rapport que supprime une simple vision cinématographique, laquelle s’éloigne par là d’autant plus du vrai qu’elle prétend se borner à lui – rapport unique que l’écrivain doit retrouver pour en enchaîner à jamais dans sa phrase les deux termes différents. On peut faire se succéder indéfiniment dans une description les objets qui figuraient dans le lieu décrit, la vérité ne commencera qu’au moment où l’écrivain prendra deux objets différents, posera leur rapport, analogue dans le monde de l’art à celui qu’est le rapport unique, de la loi causale, dans le monde de la science et les enfermera dans les anneaux nécessaires d’un beau style, ou même, ainsi que la vie, quand en rapprochant une qualité commune à deux sensations, il dégagera leur essence en les réunissant l’une et l’autre pour les soustraire aux contingences du temps, dans une métaphore, et les enchaînera par le lien indescriptible d’une alliance de mots. La nature elle-même, à ce point de vue sur la voie de l’art, n’était elle pas commencement d’art, elle qui souvent ne m’avait permis de connaître la beauté d’une chose que longtemps après dans une autre, midi à Combray que dans le bruit de ses cloches, les matinées de Doncières que dans les hoquets de notre calorifère à eau. Le rapport peut être peu intéressant, les objets médiocres, le style mauvais, mais tant qu’il n’y a pas eu cela il n’y a rien eu. La littérature qui se contente de « décrire les choses », de donner un misérable relevé de leurs lignes et de leur surface est malgré sa prétention réaliste la plus éloignée de la réalité, celle qui nous appauvrit et nous attriste le plus ne parlât-elle que de gloire et de grandeurs, car elle coupe brusquement toute communication de notre moi présent avec le passé dont les choses gardent l’essence, et l’avenir où elles nous incitent à le goûter encore.
Le Temps retrouvé.
L’œuvre de Sainte-Beuve n’est pas une œuvre profonde. La fameuse méthode, qui en fait, selon Taine, selon Paul Bourget et tant d’autres, le maître inégalable de la critique du XIXe siècle, cette méthode, qui consiste à ne pas séparer l’homme et l’œuvre, […] à s’entourer de tous les renseignements possibles sur un écrivain, à collationner ses correspondances, à interroger les hommes qui l’ont connu […], cette méthode méconnaît ce qu’une fréquentation un peu profonde avec nous-même nous apprend : qu’un livre est le produit d’un autre moi que celui que nous manifestons dans nos habitudes, dans la société, dans nos vices. Ce moi-là, si nous voulons essayer de le comprendre, c’est au fond de nous-mêmes, en essayant de le recréer en nous, que nous pouvons y parvenir.
Contre Sainte-Beuve, Marcel Proust.
Car il y avait autour de Combray deux « côtés » pour les promenades, et si opposés qu’on ne sortait pas en effet de chez nous par la même porte, quand on voulait aller d’un côté ou de l’autre : le côté de Méséglise-la-Vineuse, qu’on appelait aussi le côté de chez Swann parce qu’on passait devant la propriété de M. Swann pour aller par là, et le côté de Guermantes. De Méséglise-la-Vineuse, à vrai dire, je n’ai jamais connu que le « côté » et des gens étrangers qui venaient le dimanche se promener à Combray, des gens que, cette fois, ma tante elle-même et nous tous ne « connaissions point » et qu’à ce signe on tenait pour « des gens qui seront venus de Méséglise ». Quant à Guermantes je devais un jour en connaître davantage, mais bien plus tard seulement ; et pendant toute mon adolescence, si Méséglise était pour moi quelque chose d’inaccessible comme l’horizon, dérobé à la vue, si loin qu’on allât, par les plis d’un terrain qui ne ressemblait déjà plus à celui de Combray, Guermantes lui ne m’est apparu que comme le terme plutôt idéal que réel de son propre « côté », une sorte d’expression géographique abstraite comme la ligne de l’équateur, comme le pôle, comme l’orient.
[…]
Aussi le côté de Méséglise et le côté de Guermantes restent-ils pour moi liés à bien des petits événements de celle de toutes les diverses vies que nous menons parallèlement, qui est la plus pleine de péripéties, la plus riche en épisodes, je veux dire la vie intellectuelle. Sans doute elle progresse en nous insensiblement et les vérités qui en ont changé pour nous le sens et l’aspect, qui nous ont ouvert de nouveaux chemins, nous en préparions depuis longtemps la découverte ; mais c’était sans le savoir ; et elles ne datent pour nous que du jour, de la minute où elles nous sont devenues visibles. Les fleurs qui jouaient alors sur l’herbe, l’eau qui passait au soleil, tout le paysage qui environna leur apparition continue à accompagner leur souvenir de son visage inconscient ou distrait ; et certes quand ils étaient longuement contemplés par cet humble passant, par cet enfant qui rêvait, – comme l’est un roi, par un mémorialiste perdu dans la foule –, ce coin de nature, ce bout de jardin n’eussent pu penser que ce serait grâce à lui qu’ils seraient appelés à survivre en leurs particularités les plus éphémères ; et pourtant ce parfum d’aubépine qui butine le long de la haie où les églantiers le remplaceront bientôt, un bruit de pas sans écho sur le gravier d’une allée, une bulle formée contre une plante aquatique par l’eau de la rivière et qui crève aussitôt, mon exaltation les a portés et a réussi à leur faire traverser tant d’années successives, tandis qu’alentour les chemins se sont effacés et que sont morts ceux qui les foulèrent et le souvenir de ceux qui les foulèrent. Parfois ce morceau de paysage amené ainsi jusqu’à aujourd’hui se détache si isolé de tout, qu’il flotte incertain dans ma pensée comme une Délos fleurie, sans que je puisse dire de quel pays, de quel temps – peut-être tout simplement de quel rêve – il vient. Mais c’est surtout comme à des gisements profonds de mon sol mental, comme aux terrains résistants sur lesquels je m’appuie encore, que je dois penser au côté de Méséglise et au côté de Guermantes. C’est parce que je croyais aux choses, aux êtres, tandis que je les parcourais, que les choses, les êtres qu’ils m’ont fait connaître, sont les seuls que je prenne encore au sérieux et qui me donnent encore de la joie. Soit que la foi qui crée soit tarie en moi, soit que la réalité ne se forme que dans la mémoire, les fleurs qu’on me montre aujourd’hui pour la première fois ne me semblent pas de vraies fleurs. Le côté de Méséglise avec ses lilas, ses aubépines, ses bleuets, ses coquelicots, ses pommiers, le côté de Guermantes avec sa rivière à têtards, ses nymphéas et ses boutons d’or, ont constitué à tout jamais pour moi la figure des pays où j’aimerais vivre, où j’exige avant tout qu’on puisse aller à la pêche, se promener en canot, voir des ruines de fortifications gothiques et trouver au milieu des blés, ainsi qu’était Saint-André-des-Champs, une église monumentale, rustique et dorée comme une meule ; et les bleuets, les aubépines, les pommiers qu’il m’arrive quand je voyage de rencontrer encore dans les champs, parce qu’ils sont situés à la même profondeur, au niveau de mon passé, sont immédiatement en communication avec mon cœur. Et pourtant, parce qu’il y a quelque chose d’individuel dans les lieux, quand me saisit le désir de revoir le côté de Guermantes, on ne le satisferait pas en me menant au bord d’une rivière où il y aurait d’aussi beaux, de plus beaux nymphéas que dans la Vivonne, pas plus que le soir en rentrant, – à l’heure où s’éveillait en moi cette angoisse qui plus tard émigre dans l’amour, et peut devenir à jamais inséparable de lui –, je n’aurais souhaité que vînt me dire bonsoir une mère plus belle et plus intelligente que la mienne.
Du Côté de chez Swann.
[1] Dans À La Recherche de Marcel Proust, André Maurois fait d’ailleurs allusion à une lettre citée par la princesse Bibesco dans laquelle Proust explique que son rôle est semblable à celui d’Einstein. Observateur méticuleux des faits comme son père et son frère médecins, il veut découvrir les lois qui régissent la nature humaine.
[2] L’ouïe, le goûter, la vue sont des médias essentiels pour Proust qui, enfant, est fasciné par sa lanterne magique et, adolescent, visite plusieurs fois par semaine le musée du Louvre. Adulte, il fréquente de nombreux peintres et musiciens, sans toutefois investir sa fortune dans des toiles de maîtres.
[3] Grand bourgeois comme Swann grâce à la fortune de sa mère et à la renommée atteinte par son père le docteur Proust, Marcel garde les yeux rivés sur la classe du dessus, sur ses comtesses, ses duchesses et ses princesses. Qu’est-ce qui le pousse ainsi ? « […] son éducation trop protégée, son absence de profession (autre que celle d’écrivain), sa maladie, son homosexualité lui ont fait rechercher une évasion, une compensation, une reconnaissance dans la vie sociale. […] Enfin, pour un jeune écrivain, il fallait, à cette époque, choisir entre les cafés et les salons, si l’on voulait échapper à la solitude » (Jean-Yves Tadié, Proust, le dossier). Proust choisit les seconds, jusqu’à ce qu’il perde ses illusions.
[4] Les Weil sont rattachés aux Berncastel, Neuburger, etc., ce qui fait de Marcel Proust un cousin éloigné de… Karl Marx !… et un parent par alliance d’Henri Bergson, qui épouse en 1892 une cousine de Proust, Louise Neuburger.
La fortune des Weil s’est surtout accrue avec la manufacture de porcelaine de Baruch Weil, sous le Premier Empire.
[5] Qui, quoi qu’on en pense, n’a pas passé toute sa vie d’adulte cloîtré dans une chambre. Il a même été, jusqu’en 1914, un voyageur… fatigable en France, en Suisse, aux Pays-Bas, en Italie (cf. Voyager avec Marcel Proust, Anne Borrel).
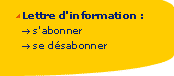


![]()
![]()






